Galerie des ancêtres

Olivier Abel
Philosophe français né en 1953, théologien, professeur de philosophie éthique. Proche du philosophe Paul Ricœur, il a publié de nombreux ouvrages et articles, en particulier sur les anges, la mémoire et le pardon. Dans les discussions que nous avions autrefois, il m’avait aidé notamment à dépasser le syndrome de la page blanche.
«Cesse de jouer à Pénélope» me disait-il alors, «arrête de défaire le soir ce que tu as fait dans la journée!».
Le conseil s’est révélé plus qu’utile… et efficace !

Roland Barthes (1915-1980)
Critique littéraire et sémiologue, il enseigna en particulier au Collège de France. J’ai découvert Roland Barthes au moment de mes années universitaires en lettres classiques et j’ai dévoré Le degré zéro de l’écriture (1953) comme un roman. C’était la première fois que je découvrais une critique littéraire soucieuse du texte dans sa logique interne {« tout le texte, rien que le texte »). Le non moins célèbre Mythologies (1957) me fascinait autant par son contenu (l’examen des mythes modernes, de la Citroën DS au visage de Greta Garbo) que par la méthode et le style, inimitable. Et puis il y eut le très beau Fragments d’un discours amoureux (1977). Sa leçon inaugurale au Collège de France, prononcée le 7 janvier 1977, a longtemps été une référence pour moi, en particulier lorsque Barthes articule le discours comme façon d’assujettir, la littérature comme échappatoire au pouvoir de la langue et la sagesse de désapprendre.

Hildegarde de Bingen (1098-1179)
Difficile de décrire un personnage aussi protéiforme : mystique, prédicatrice, abbesse, compositrice, poétesse, spécialiste de médecine monastique. J’ai découvert Hildegarde au début des années 1990, lorsque je me suis attachée à l’étude de femmes mystiques dans le christianisme. Avant Julian de Norwich, Adewijch d’Anvers ou Catherine de Sienne, elle a su développer un rapport à la spiritualité totalement novateur, en tous les cas pour une femme de cette époque. La clôture des merveilles (2013) de Laurence Nobécourt constitue pour moi l’une des plus flamboyantes interprétations contemporaires de la vie d’Hildegarde.

Carolyn Bohler
J’ai rencontré Carolyn lors de mon année d’études à United Theological Seminary (Dayton, Ohio) en 1985, où elle occupait la chaire de théologie pastorale et de «counselling», mot intraduisible qui signifie à la fois conseil et accompagnement. Dès ses premiers cours autour des métaphores pour imaginer à neuf la figure de Dieu, j’ai senti que j’avais trouvé en elle une alliée pour mes propres recherches. A la fin de chaque période de dix semaines, nous devions rédiger un travail théologique conséquent et je cherchais alors comment sortir de la forme académique traditionnelle. Avec Carolyn, grâce à son ouverture d’esprit, j’ai pu développer une sorte de théologie narrative, inconnue jusque-là en Europe. C’est à ce moment que, dans mon récit, est apparue pour la première fois l’ange Gabrielle, que j’ai souvent évoquée depuis.
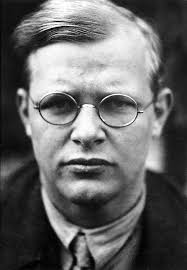
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
On connait la trajectoire fulgurante de ce théologien allemand prometteur, interrompue en plein vol un matin glauque d’avril 1945, au camp de concentration de Flossenbürg en Allemagne. Théologien hyper doué, pasteur empathique et enjoué, accompagnant hors-pair d’une jeunesse déroutée, pour moi, Bonhoeffer demeure avant tout un visionnaire, penseur du passage du christianisme avant même qu’on l’imagine par ailleurs. Certes sa mort à 39 ans ne lui a pas laissé le temps d’élaborer ce passage autrement que par des bribes mais il avait, déjà, parfaitement saisi et anticipé l’évolution spirituelle de notre temps.
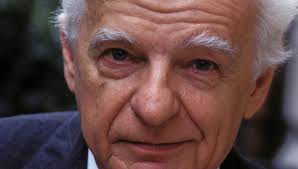
Yves Bonnefoy (1923-2016)
Reconnu aujourd’hui comme l’un des poètes français majeurs de la deuxième partie du 20e siècle, Yves Bonnefoy représente pour moi l’expérience d’un langage au service de l’essentiel. La lecture de son recueil Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953), alors que j’étais une jeune étudiante de Khâgne, a constitué un moment déterminant : ainsi la parole poétique était capable de traduire la réalité du vivant et de la mort en des termes aussi intenses que la parole du religieux.

Katharina von Bora (1499-1552)
Connue essentiellement pour être la femme de Martin Luther, Catherine de Bora est d’abord une religieuse qui, à la lecture d’un ouvrage de son futur époux, décide en 1521 de fuir son couvent, au cours d’un épisode romanesque qui la conduit à Wittenberg où elle est hébergée chez la femme du peintre Lukas Cranach. C’est là qu’elle rencontre Martin Luther et l’épouse en juin 1525. Elevant leurs six enfants, administrant le domaine familial, elle nous est également connue par les échanges épistolaires avec son époux. On devine une femme d’une grande personnalité, drôle, pleine d’énergie et aimant par-dessus tout la vie. Elle meurt des suites d’un accident de la circulation à Torgau en 1552. En 2014, j’avais été invitée à Torgau qui organisait une exposition autour de Catherine. J’y avais présenté un dialogue, fictif, entre Catherine de Bora et Idelette de Bure, la femme de Calvin dont nous savons très peu. Plus généralement, Catherine de Bora m’aura permis de dévoiler ces figures de femmes de la Réforme que j’ai, par la suite, étudiées et présentées. Loin d’être de simples potiches ou des femmes «de», elles étaient, à leur manière, de véritables réformatrices.

Lavinia Byrne
Née en 1947, Lavinia Byrne a été une religieuse convaincue, mais tout aussi convaincue par la nécessité de combattre le statut actuel des femmes dans l’Eglise catholique. Je l’ai rencontrée à Genève dans les années 1990, lorsque je l’avais invitée à présenter ses recherches autour des femmes dans l’histoire du christianisme, notamment dans son anthologie The Hidden Tradition. Car, comme d’autres, Lavinia Byrne a beaucoup travaillé à réveiller ces mémoires oubliées. Elle m’avait dédicacé son livre Women before God en me qualifiant de «Christ bearing-woman» ! Après sa conférence nous avions été faire du shopping et avions beaucoup ri ! J’ai appris depuis qu’après 35 années d’engagement au sein de son institut religieux, elle l’avait quitté en 2000, affirmant avoir subi des pressions de la part du Vatican pour qu’elle abandonne son soutien aux femmes prêtres.

Jean Calvin (1509-1564)
On a déjà tout dit du réformateur de la sphère francophone de l’Europe du 16e siècle. J’ai moi-même écrit une biographie destinée au jeune public des écoles suisses. Lors de l’anniversaire de ses 500 ans, en 2009, alors directrice du Musée international de la Réforme, j’ai organisé une grande exposition temporaire « Une journée dans la vie de Calvin » qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs tant suisses que du monde entier. A cette époque j’ai notamment tenté de débusquer le Calvin « humain » derrière la froideur du théologien, comme en témoignent mes recherches autour des femmes qui ont traversé sa vie. Mais au-delà de toutes ces activités culturelles et universitaires, la figure de Jean Calvin a surtout joué pour moi l’ombre d’une figure tutélaire bienveillante voire amusée. Lorsque le jeudi 6 septembre 2001 en fin d’après-midi, j’ai été installée comme première modératrice de la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, lors du culte du Jeûne genevois à la cathédrale St-Pierre, j’avais d’abord été me recueillir sur la tombe du premier modérateur, au cimetière des Rois. On sait que la pierre tombale actuelle, datant du 18e siècle, n’est là que pour combler le vide d’une énigme puisqu’on ne connait pas exactement l’endroit où Calvin est enterré. Le réformateur avait souhaité en effet être mis dans la fosse commune pour éviter tout début de culte de la personnalité. Cela étant, je me suis rendue devant cette tombe symbolique pour y poser un bouquet de roses et demander à sa mémoire de me laisser un peu de place pour exercer ce ministère à ma façon. Quelques années plus tard, en octobre 2009, lorsque je me suis rendue à La Havane pour inaugurer un buste du réformateur, j’ai constaté avec plaisir que le sculpteur avait laissé paraître un léger sourire sur son visage. Calvin, enfin heureux dans la chaleur des Caraïbes !

Athanase Coquerel (1795-1868)
J’ai entendu parler de ce pasteur libéral du 19e siècle au début des années 1980, lorsque je cherchais un sujet de thèse pour mon doctorat en théologie. Alors que je souhaitais travailler sur un sujet reliant mes deux centres d’intérêts, les lettres et la théologie, le professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, Gilbert Vincent, m’avait proposé de m’attaquer à la rhétorique des discours de persuasion. Après quelques recherches, j’ai découvert deux ouvrages de prédications d’Athanase Coquerel, publiés au milieu du 19e siècle, et je dois admettre que je suis tombée sous le charme de ce style emporté, si convaincant, si habile aussi, bien avant l’ère des télévangélistes. Du point de vue de sa doctrine, Athanase était libéral, développant déjà une approche critique des textes bibliques. Lors de la soutenance de ma thèse, le 9 février 1988, le regretté Olivier Reboul, professeur en sciences sociales à Strasbourg qui m’avait initié à la « nouvelle » rhétorique et membre du jury, se leva pour lire quelques pages d’Athanase Coquerel. Toute la salle en fut bouleversée !

Marie Dentière (1495-1561)
En novembre 2002, lors de la commémoration de la Réformation, on dévoila le nom de la première femme du monument des Bastions à Genève. Pas directement sur le Mur des Réformateurs mais sur l’un des blocs perpendiculaires, figure désormais Marie Dentière. Pourtant, pendant des siècles, le moins que l’on puisse dire c’est que ce personnage historique n’a pas bénéficié d’une réputation élogieuse. Plusieurs réformateurs, dont Jean Calvin, se sont empressés en effet de dessiner une sorte de légende noire autour d’elle. Fort heureusement, l’état de la recherche contemporaine a changé la vision que l’on peut avoir de cette femme exceptionnelle, reconnue aujourd’hui comme l’une des premières intellectuelles de la Réforme, historienne, pédagogue et fine théologienne. Avec la journaliste Virginia Crespeau, nous avions réalisé en 2007 un documentaire pour France 2 pour montrer le visage d’une femme qui avait payé au prix fort son engagement au sein de la Réforme protestante, le prix d’un silence forcé et d’une réputation déformée.

André Dumas (1918-1996)
Parmi mes maîtres, j’aurais pu citer Gérard Siegwalt (né en 1932), professeur de dogmatique à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et fondateur d’un mouvement de spiritualité luthérienne destiné aux jeunes intellectuels, le Compagnonnage St-Michaël dont j’ai fait partie au début des années 1980. J’aurais pu également mentionner Gilbert Vincent, mon directeur de thèse ou Olivier Reboul (cf. Athanase Coquerel). Mais avec André Dumas, ce théologien d’une finesse et d’une subtilité qui m’impressionnaient beaucoup lorsque je suivais ses cours d’éthique à Strasbourg, j’ai découvert que l’écriture, déroulée au service du sens, ne s’opposait pas à l’argumentation des idées. Longtemps, en théologie, on avait considéré mon style comme suranné et trop littéraire. Avec l’exemple d’André Dumas, j’ai pu enfin développer ma propre écriture sans avoir à rougir d’y accorder une importance signifiante.

T. S. Eliot (1888-1965)
Eliot, de son nom complet Thomas Stearns Eliot, incarne pour moi l’émotion poétique au paroxysme du sens. J’aurais pu citer de la même façon René Char, Stéphane Mallarmé ou St John Perse, qui tous ont su m’émerveiller, pour ne pas dire me faire tressaillir. Néanmoins c’est appuyée à la poésie d’Eliot, prix Nobel de littérature en 1948, que j’ai pu développer ma proche approche d’une réécriture biblique aux multiples résonances. Sorte de méditation autour du temps, de l’univers et du divin, Four Quartets, en particulier, reste une œuvre majeure pour moi, que ce soit dans sa version originale de 1943 ou dans sa traduction en français de Claude Vigée en 1992, lui-même figure importante de la littérature poétique.
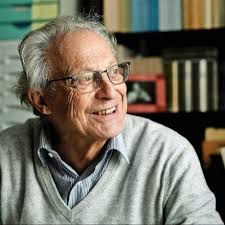
Marc Faessler
Né en 1940 à Genève, Marc Faessler a joué un rôle essentiel dans l’histoire de la théologie francophone du 20e siècle. De par ses intérêts pour la psychanalyse, l’étude juive des textes bibliques et l’éthique, Marc Faessler a su, grâce à son œuvre écrite mais aussi par son ministère au Centre protestant d’études, tracer des lignes de convergence entre des paroles, des milieux, des personnalités que tout opposait. C’est grâce à Marc Faessler que l’on a pu entendre pour la première fois à Genève Françoise Dolto, Marc Levinas ou Catherine Chalier. Lorsqu’il a pris sa retraite, en 2006, nous avions organisé un colloque pour lui rendre hommage. J’avais pour ma part tenté de décrire sa parole aux arcanes du Souffle, une parole profondément libre. A titre plus personnel, Marc aura été depuis mon arrivée à Genève un ami d’une fidélité à toute épreuve. Un ami qui attendait beaucoup de moi, qui m’a parfois fort bousculée pour me faire sortir de ce qu’on appelle aujourd’hui ma « zone de confort ». C’est donc aussi grâce à Marc Faessler que je suis devenue la théologienne que je suis aujourd’hui.
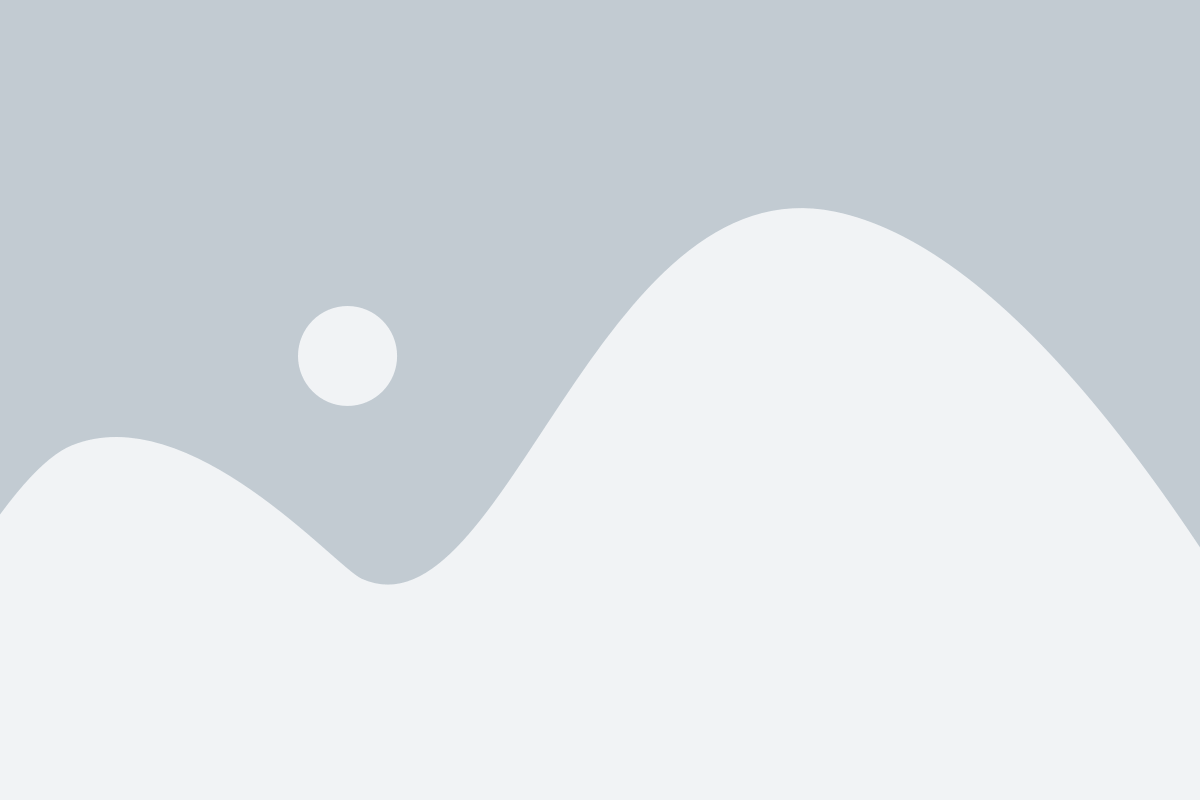
Nicole Fischer-Duchâble
C’est au printemps 1981 que j’ai croisé Nicole Fischer pour la première fois. J’achevais une année d’études en théologie à l’université de Genève et l’on m’avait conseillé d’assister à une séance du Consistoire de l’Eglise (sorte de parlement législatif instauré au 16e siècle à Genève par Jean Calvin). Dans cette paroisse moderne du centre-ville, j’ai vu alors arriver une petite dame au grand sourire et à la force de caractère évidente. C’est elle qui présidait l’exécutif de l’Eglise et c’est la première fois que je «voyais» littéralement un pouvoir aux mains d’une femme déterminée et pleine d’autorité. Je n’ai jamais oublié cette soirée! Plus tard, lorsque nos chemins se sont croisés à nouveau et que nous sommes devenues des amies, Nicole m’a fait participer au programme de la Décennie des Eglises en solidarité avec les femmes (1987-1997), initiée par le Conseil œcuménique des Eglises à Genève. J’ai ainsi été envoyée, en équipe, visiter les Eglises d’Australie puis d’Islande et de Norvège. Ces visites en forme de «lettres vivantes» m’auront marquée à jamais.

Aruna Gnanadason
J’ai rencontré Aruna dans le même contexte que celui de Nicole Fischer, lorsqu’Aruna est arrivée à Genève, en 1991, pour y assumer le poste de responsable «Femmes et Eglises» au Conseil œcuménique des Eglises. Grâce à elle, j’ai pu découvrir un autre monde, celui des théologiennes des quatre coins de la planète, celui de leur pensée, si différente, si exaltante, si exigeante aussi. Grâce à Aruna, j’ai pu me confronter à des personnalités incroyables qui ont profondément influencé ma pensée et ma trajectoire. C’est elle notamment qui m’a invitée à des conférences de théologiennes asiatiques ou africaines dans les années 2000, arguant que je n’étais certes ni asiatique ni africaine mais que le premier monde que je représentais gagnerait à sérieusement écouter ce que cet autre monde avait à dire. Et lorsque j’avais la chance de partager un repas indien cuisiné par Aruna et que nous passions la soirée, avec son mari Jonathan, à refaire le monde, je rentrais chez moi régénérée et affirmée.

Jean-Yves Leloup
Né en 1950, Jean-Yves Leloup est un prêtre français d’abord dominicain puis converti à l’orthodoxie. J’ai découvert son œuvre il y a longtemps déjà, lorsque je cherchais d’autres interprétations bibliques que celles que l’on m’avait enseignées dans les facultés de théologie. Comme une assoiffée dans le désert, je n’en pouvais plus de travailler sur des démonstrations historico-critiques. L’approche spirituelle de Jean-Yves Leloup m’a donc tout de suite interpellée puis fascinée. Je lui dois beaucoup dans l’évolution spirituelle qui a été la mienne les dernières décennies.

Marivaux (1688-1763)
Mon affection pour cet auteur de théâtre du 18e siècle date de mes années d’études de lettres. Après les classes préparatoires et leur exigence, j’avais débarqué en faculté de lettres un peu détachée. A la faveur d’un cours magistral sur les figures de contestation littéraire à la veille de la Révolution française, j’avais découvert le théâtre de Marivaux sous un autre jour, au-delà des marquis poudrés et des servantes gourgandines. Dépassant les fulgurances de Molière, les tragédies antiques de Racine ou Corneille, Marivaux sent le vent du changement politique et sociétal et le manifeste dans son écriture, leste et sombre. Avec Marivaux j’ai découvert que l’écriture, y compris théâtrale, pouvait non seulement servir un projet politique mais devenir elle-même un objet politique.
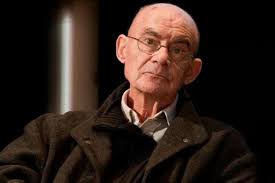
Jean-Luc Nancy (1940-2021)
Lors de mes années de « prépa » à Fustel de Coulanges, à Strasbourg, alors que nous étions débordés de cours et de travaux à rendre, chaque semaine nous courions, toute une bande, à la faculté des lettres pour suivre le cours magistral de philosophie donné par Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Il fallait arriver au moins une heure à l’avance pour avoir une place assise ! La même année, son épouse Claire Nancy nous donnait de formidables cours de grec, mêlant traduction, philologie, philosophie et histoire. Par la suite, j’ai dévoré chaque livre de Jean-Luc Nancy, appréciant en particulier sa pensée autour du sens et du non-sens. Ses réflexions sur la « pensée dérobée » ont influencé mes propres recherches d’alors. Sur le tard, j’ai souhaité l’inviter pour une conférence à Genève mais sa santé ne lui permettait plus guère de déplacements. Sa réponse, d’une grande sollicitude, m’avait beaucoup touchée.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)
On a déjà tout dit de ce philosophe hors norme, de ses concepts phares qui font encore mouche aujourd’hui, de la « volonté de puissance » au « surhomme » ou à « l’éternel retour ». Pour ma part, je l’ai beaucoup lu et travaillé au temps de mes études de lettres alors que je traversais par ailleurs une véritable crise de doute religieux. Je me souviens de cette époque où, avec l’excès d’une presque encore adolescente, je mettais sur la balance le nihilisme nietzschéen et la foi chrétienne. D’une certaine manière, j’ai alors accepté la mort de Dieu prônée par le philosophe, en tous les cas la mort d’une certaine représentation de Dieu.

Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826)
Chaque enfant alsacien rencontre un jour la figure de Jean-Frédéric Oberlin, pasteur piétiste et adepte du progrès social au cœur d’une vallée perdue des Vosges en plein 18e siècle. Pour mon père, il faisait figure de héros du passé et nous nous rendions souvent en famille à Waldersbach en une sorte de pèlerinage culturel et religieux. Il serait fastidieux de décrire ici tous les aspects de la vie incroyable de cet homme visionnaire, dans tous les sens du terme. Pendant mes études de théologie, j’ai pu effectuer quelques remplacements pastoraux d’été. C’est ainsi qu’au début des années 1980 j’ai passé un mois à Waldersbach, célébrant des cultes dans la petite église attenante au presbytère, là où mes parents m’emmenaient déjà certains dimanches alors que j’étais toute petite. Plus étonnant était que dans mon cahier des charges figurait la visite régulière d’une sorte de petit musée d’objets ayant appartenu à Oberlin. Sans le savoir je préparais déjà ma future étape professionnelle de directrice de musée !

Ofelia Ortega
La pasteure Ofelia Ortega, membre de l’Eglise presbytérienne réformée de Cuba, a été la première femme ordonnée dans sa dénomination. De 1996 à 2004, elle a été rectrice du séminaire théologique de Matanzas, haut lieu de la théologie de libération latino-américaine. Je l’ai rencontrée pendant sa période genevoise, de 1985 à 1996, d’abord comme professeure à l’Institut œcuménique de Bossey puis dès 1988 comme secrétaire exécutive pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans la formation théologique. Elle présidait une conférence de femmes à laquelle elle m’avait demandé de participer en donnant une communication. Je me rappellerai toujours sa réaction enthousiaste après mon intervention et sa promesse, tenue, d’une publication de mon texte. Pour la première fois une théologienne reconnaissait en moi une parole et une pensée digne d’être partagée. Bien plus tard, lors de mon séjour à Cuba en 2009, pour l’inauguration du buste de Calvin à la Havane, j’ai fait le déplacement à Matanzas, où elle avait toujours sa place et grâce à elle, j’ai été invitée à donner deux cours sur ma réflexion théologique. Son accueil et celui de ses collègues avait été tout aussi enthousiaste qu’à Genève autrefois !

Emma Pieczynska Reichenbach (1854-1927)
A la mort d’Emma Pieczynska-Reichenbach, en 1929, un groupe d’amis fit paraître un recueil de ses lettres. C’est à partir de ce livre, épuisé, que j’ai travaillé pour éditer, à mon tour, un choix de sa correspondance, en 2004. J’avais fait précéder ces lettres d’une biographie centrée, au-delà des faits historiques, sur la spécificité de cette femme remarquable, intellectuelle engagée socialement, vivant avec une autre femme célèbre au sein du mouvement féministe de la fin du 19e siècle, Hélène von Mülinen, mais surtout une âme en recherche constante d’éblouissements spirituels. A travers cette vie ponctuée d’espérances et de chutes, d’épreuves et de renoncements, j’avais vu se dessiner sinon un modèle du moins une trajectoire à laquelle je pouvais m’associer pour ne pas dire m’appuyer.
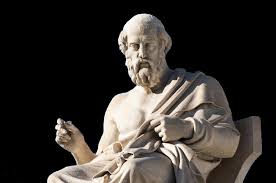
Platon (-428– -348)
On ne présente pas ce philosophe grec qui a tant apporté à la pensée occidentale. Un souvenir me lie à son œuvre, lorsque sur les bancs de la classe de khâgne, je traduisais le Banquet, éblouie par tant d’intelligence et de subtilité. Plus tard, en lisant la République, j’ai mieux compris les chaos de l’histoire politique récente. Encore aujourd’hui, je trouve dans la pensée platonicienne, certes complexe, de quoi nourrir ma réflexion.
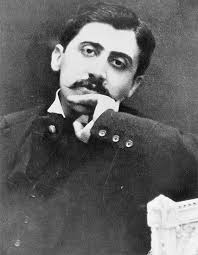
Marcel Proust (1871-1922)
Un peu comme le confessait André Gide à propos de Victor Hugo – « le plus grand écrivain… hélas ! », on pourrait sans doute considérer Marcel Proust comme appartenant au panthéon de la littérature mondiale. Pour ma part, je l’ai découvert à la fin de mon adolescence et je l’ai dévoré, grâce aux volumes de la Pléiade que mes parents avaient eu la générosité de m’offrir. Sorte d’écriture totale, en spirale et en débauche de mots et des phrases, l’œuvre de Proust m’a séduite dès le début car au-delà du style inimitable, je l’ai perçue comme une tentative d’embrasser la réalité du monde, qui toujours se dérobe. Le souvenir d’une image perdue, perçu comme le regret d’un instant, rebondissant vite par une autre image, une autre sonorité, une autre couleur, voilà ce qui m’a touchée et qui continue d’habiter ma réflexion sur le temps, la mémoire et la vie.

Letty Russell (1929-2007)
Théologienne engagée et reconnue, Letty Russell a marqué des générations d’étudiant·es en particulier à Yale où elle a enseigné de nombreuses années. Mais elle a également fait partie du mouvement œcuménique, notamment au sein du groupe « Foi et Constitution ». Parmi ses nombreux ouvrages, celui qui m’a le plus fait avancer concerne l’ecclésiologie en mode féministe : Church in the Round. Feminist Interpretation of the Church (1993). Sa dédicace, lors d’une rencontre de théologiennes à Accra, au Ghana, m’avait beaucoup touchée : «To Isabelle, My sister in Christ. Many blessings as you work to create ways of Church in the round in Geneva». J’avais eu la chance de lui rendre visite, chez son épouse Shannon Clarkson et elle, dans un cottage historique de la Nouvelle Angleterre. Elle rayonnait de simplicité et d’intelligence.

Elisabeth Schüssler Fiorenza
Née en 1938 en Roumanie, Elisabeth Schüssler Fiorenzy est une théologienne féministe en particulièrement connue pour ses recherches sur les femmes de et dans la Bible. Alors que je commençais mon ministère pastoral genevois par quelques mois dans la jolie paroisse de campagne, à Vandœuvres, son ouvrage majeur venait d’être traduit en français dans une prestigieuse collection théologique : En mémoire d’elle : essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe (1986). M’appuyant sur ses interprétations bibliques pour mes prédications, je crois avoir quelque peu effarouché les paroissiennes et paroissiens habitués alors à davantage de tempérance.

Daniel Sibony
Né en 1942, Daniel Sibony est un mathématicien, philosophe et psychanalyste français. C’est d’abord par ses ouvrages que je l’ai rencontré, en particulier celui sur l’Entre deux : l’origine en partage (1991). Je découvrais alors une analyse si pertinente, qui rejoignait mes propres questions sur l’origine. Je l’ai ensuite invité à plusieurs reprises à Genève pour des conférences toujours très suivies.

Elizabeth Tapia (1950-2025)
J’ai rencontré Elizabeth Tapia d’abord lors de rencontres théologiques à Bossey, l’institut du Conseil œcuménique à Genève. Nous avions immédiatement apprécié chez l’une comme chez l’autre la vivacité pour ne pas dire la fougue de nos élucubrations intellectuelles. Lors de mon temps sabbatique à l’automne 2000, j’avais effectué un voyage ecclésiologique en Asie, en passant par la Corée et les Philippines. Elle m’avait alors accueillie dans son séminaire, en pleine campagne, à une heure de Manille. Nous avions continué nos échanges intenses et drôles, en particulier lorsqu’elle m’entraîna, une après-midi, dans un salon de beauté pour, disait-elle, casser la laideur du monde.

Marguerite Yourcenar (1903-1987)
On connaît bien cette femme de lettres, première académicienne élue en 1980 à la vénérable institution jusque-là uniquement réservée aux hommes. Dès ma jeunesse j’ai été profondément éblouie par Les mémoires d’Hadrien (1951) et L’œuvre au noir (1968). A la fois pour leur force romanesque, pour la langue inimitable, créatrice de sens, et le rythme, l’envolée, le souffle. Sur la dalle funéraire où reposent ses cendres, à Mount Desert, aux Etats-Unis figure cette épitaphe tirée de L’œuvre au noir : « Plaise à Celui qui est peut-être de dilater le cœur de l’homme à la mesure de toute la vie. »
